Extrait “Le petit-boutiste”
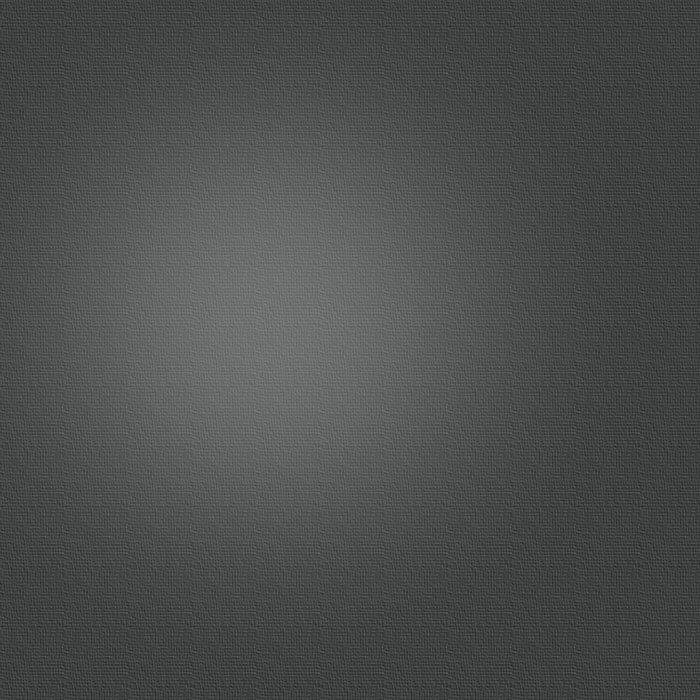
« Peut-être ma vie n'a été qu'un rêve
Rêvé à travers moi par l'esprit des autres »
T.S. Eliot, la Réunion de famille
Il est parti ! C'était un soir, je venais de poser mes bagages dans le couloir et m'apprêtais à allumer un feu. J'avais les yeux lourds, fatigués par trois heures d'autoroute, les jambes ankylosées ; l'estomac réclamait à manger. J'étais encore en vacances, fier de mon teint hâlé, fier également de ma moyenne horaire. J’essayais de mettre la main sur une boîte d’allumette quand le téléphone a sonné, déchirant le silence de la maison froide. J’ai maudit celui qui ne me laissait pas le temps de défaire mes valises et j'ai décroché.
Il est parti ! On m'a dit qu'il était tombé dans l'eau. On m'a dit que tout avait été très vite et qu'on ne savait pas encore grand chose des circonstances de l'accident. On a aussi raconté qu'il était dans un petit avion, que son copain tenait le manche et que c'était un aviateur chevronné qui aimait beaucoup les acrobaties. On a dit qu'il s'amusait à raser les vagues du lac. Il paraît que c'est courant quand on est un bon pilote, qu'il n'y a rien de plus fascinant, que l'eau et le ciel se confondent dans un même émoi. On a aussi affirmé que l'avion valait un million de francs et que des pêcheurs l'avaient vu tomber dans l'eau glacée. Ils ont eu tout juste le temps de repêcher le pilote qui était à peine commotionné. Quant à lui, il est parti au fond de l'eau, attaché à la carlingue, là où il y a un village englouti. On a beaucoup parlé de cette eau froide, translucide, gorgée de sable, dont les reflets turquoises évoquent la fonte des grands glaciers. On a aussi parlé de destin, de sale coup du sort. Pour finir, on a dit que c'était une belle sortie, que tout ça lui ressemblait assez bien, finalement. On a dit beaucoup de choses, mais avec les mots il n'est pas revenu.
Il est tombé dans le lac, mais quand je pense à lui, je regarde le ciel et souvent un rayon de soleil perce entre deux nuages.
Nous ne parlons pas de lui. Nous ne parlons pas des morts. On regarde chacun notre coin de ciel tandis qu'une petite voix profonde semble nous dire : « Est-ce possible ? »
Quand je croise des amis communs, on n’évoque guère son souvenir. Il semble parfois se faufiler dans nos conversations anodines, entre deux échanges de mots. C'est un silence, une image qui revient, un contour, un geste de ses bras, quelques-uns de ses mots favoris. Mes yeux s'échappent dans le vague, le temps d'un souvenir imprécis. Dans ceux des autres aussi, je devine qu’il est là, comme une traînée de poudre traversant leur mémoire. Ils se ressaisissent vite et le fil de nos conversations est à peine troublé.
Une image me revient. C'était au début de l'hiver, il y a bien longtemps. Le ciel était encore limpide, d'un bleu profond et dense, le soleil ne voulait pas nous quitter. On s'accommodait plutôt bien de ces circonstances climatiques et nous passions nos journées dehors. Nous étions sur un parking, adossés à une falaise de calcaire luisante quand un homme de petite taille, la trentaine affichée, les épaules rentrées, s'est approché de moi. D'épaisses lunettes noires masquaient son visage d'où émergeait un nez volontaire. Il portait une grande veste décousue, à carreaux, ses cheveux ondulaient sur ses épaules. Nous devions travailler ensemble sur un film de promotion pour une association alpine. Le tournage allait commencer d’une minute à l’autre, devant la vitrine d’un vendeur de couteaux.
Sans crainte, le petit homme se présente et me demande qui je suis. « Moi, c'est Christophe, mais on m'appelle Prof. Je suis le gars du son », annonce-t-il. Quant à moi, j'étais assistant à la réalisation. Je lui tends son matériel composé d'un gros magnétophone, d'une perche et de quelques micros. En connaisseur, il regarde l'engin et affiche un sourire satisfait. « Y'a pas mieux, parait-il » me dit-il. « C'est parfait », je lui dis. Je le laisse là et, quelques secondes plus tard, il revient vers moi la mine contrariée. Sans grand complexe, il me demande comment se branche le magnétophone. Bien sûr, comme j’ai pu le constater par la suite, il en savait beaucoup plus que moi sur la question, à un ou deux détails près. Peut-être voulait-il ne pas avoir l'air ?
C'était lui...
Il y a onze années de cela. Oui ! je me souviens, je garde encore quelques images, quelques bribes de ses paroles autrefois prononcées. Mais ce n'est pas pour faire un mythe, ni reconstruire une histoire du genre : « Qu'il était formidable mon copain... » Non ! Simplement, ces mémoires d'instants font partie de moi. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'elles...
L'avion n'a pas atterri, son aile a touché l'eau et lui le fond. Des pêcheurs ont transporté le pilote sur la berge et les secours sont arrivés. Aux gendarmes, il a raconté sa version de l'accident. Il volait au-dessus du lac et s'apprêtait à effectuer un grand virage vers le nord. À ce moment-là, il aurait été victime d'un malaise passager, d’un « trou noir », et n’aurait retrouvé ses esprits que quelques secondes plus tard, au moment où l'avion piquait sur l'eau. Trop tard, impossible de redresser l'appareil. Ensuite, sous la violence du choc, le cockpit a explosé.
Dans un réflexe de survie, le pilote a réussi à détacher sa ceinture et l'appel d'air créé par son parachute de secours l'a entraîné vers la surface. Quelques minutes plus tard, il se réchauffait, emballé dans une couverture de gendarme et expliquait les circonstances de l’accident. Le lendemain, il rentrait chez lui, après un sombre détour dans la maison de son ami englouti.
Autour de moi, les bruits, les rumeurs, les colères vont bon train : « C'était un excellent pilote, un fou de voltige, un de ceux qui n'ont pas froid aux yeux, ceux dont on a l'impression qu'ils n'ont rien à perdre ; ce n'est pas la première fois qu'il revient de la mort ; quand on vole au-dessus d'un lac, c'est pour faire du rase-mottes, sinon on se contente de survoler les prés et on respecte scrupuleusement les couloirs aériens ; les lacs sont comme des miroirs, fascinants et dangereux, ils donnent à l'aviateur périlleux une impression de vertige extraordinaire ; son aile frôlait la surface de l’eau ; il adorait faire peur à ses passagers, c’était un de ses jeux favoris ; il n'avait aucune raison de prendre ce chemin-là, ce n'était pas la route naturelle pour rejoindre l’aéroport de Valence ; il n’avait pas l’autorisation de survoler ce lac... » Quand, avec ses anciens collègues ou ses amis, nous évoquons ce dernier week-end de printemps le ton monte rapidement. On fustige le pilote, on maudit son incurie, son silence, ses contusions. On lui attacherait bien une pierre à la cheville avant de lui offrir un beau plongeon dans l’eau glaciale.
Ce jour-là, il devait vendre son avion ; c'était son dernier vol. Un biplace en ligne avec le siège du passager à l'avant.
La veille au soir, ils avaient fêté ça, paraît-il. Ils s’étaient rendus à une soirée et avaient descendu quelques verres. Sans excès pourtant. Ils s'étaient même ennuyés à mourir et s’étaient couchés tôt, on m’a dit. « A une heure raisonnable... »
Malgré tout, le pilote confia plus tard qu'il ne se sentait pas très bien au moment du départ, l'estomac en bataille ou le foie contrarié, on ne sait pas.
Je m’aperçois que je le connaissais mal. Aux lendemains de sa mort, en rencontrant ceux qui l'avaient côtoyé au quotidien, je lui ai découvert de nouveaux visages. En regardant les autres, leur tristesse contenue, il me semblait retrouver quelques-unes de ses attitudes, parfois l’esquisse d’un de ses gestes. Comme s'il restait une part de Lui en chacun de nous. Une part différente malgré tout, comme les pièces dispersées d’un immense puzzle. On ne pouvait rien partager.
Dans la ruelle qui lui avait servi de nid, on se réunissait, silencieux. Entre deux thés, une cuillerée de miel, quelques tartines, on guettait son absence. Chacun avec son souvenir, son petit bout de Lui, caché quelque part dans les plis de la mémoire. D’un coup, un flot de paroles envahissait son salon, souvent à l’approche des repas, et nous retombions ensuite rassasiés, chacun sur son fauteuil, habités de pensées tumultueuses.
C'est vrai ! il avait mille visages qui m'étaient inconnus, je m'en rends compte aujourd'hui. Moi qui croyais le connaître de la tête aux pieds, pensant être un complice des instants les plus précieux, le confident de ses tourments. Peut-on dire que c'était un individu joyeux, heureux de vivre, épicurien, libéré ? D’une simplicité sincère ? Peut-on dire aussi que derrière ses lunettes, son regard était triste, angoissé, qu'il avait peur de vivre, souffrant de faire les choses à moitié ? Ou qu'il se fichait de tout, jouant d’une dérision sans faille ? N'était-il pas bien dans sa peau, d'une détermination certaine, d'un caractère intransigeant, peu enclin aux concessions ? Etait-il prêt à tout pour faire plaisir, pour être aimé ou simplement reconnu ? Tout est vrai. Qui était-il, ce petit bonhomme que j'ai croisé pendant dix ans sur de nombreux chemins, au travail, chez lui, autour d’une bouteille ou de projets ? Adolescent ? Irresponsable ? Philosophe ? D'une maturité hors du commun ? Sûr de lui, de son talent ? Errant sur les routes, les bras en avant, comme un aveugle sans sa canne ? Je n'en sais rien. Tour à tour ou en même temps, avait-il tous ces visages ? Ou bien aimait-il changer d'apparence pour échapper au regard des autres ? À moins que, d'une manière générale, l'être échappe aux mots, à la définition, à la compréhension des autres.
Quelques jours après sa mort, chez lui nous avons découvert une petite boîte à bijoux remplie de photos d'identité prises dans différents pays. Christophe déguisé en marchand du temple, en vendeur de sabres jordaniens ; Christophe en rocker, avec ou sans moustache, gominé, affichant tantôt des airs d’intellectuel russe tantôt de paysan franchouillard, une chemise à carreaux sur le torse, un vieux béret poussiéreux pour cacher ses cheveux ; Christophe en homme du monde, costume trois pièces, smoking, la raie au milieu, le sourire impérial, habillé à la mode 1900, tout droit sorti d'une pièce de Tourgeniev. Barbu, imberbe, cheveux courts, cheveux longs, avec ou sans lunettes, l'œil terne ou brillant. En regardant ces photos, je pensais immédiatement à « Zelig » ce personnage créé et interprété par Woody Allen, sorte d'homme-caméléon qui se fond dans la masse, à l'aise parmi tous les groupes sociaux, se faufilant dans les situations les plus extravagantes et dont le visage et l’allure se transforment selon les circonstances. Ces photos, toutes prises dans des photomatons, il ne les avait jamais montrées. Personne, pas même sa mère ni sa compagne, ne semblait connaître leur existence. Elles étaient pourtant dans son bureau, bien en vue au bord d'une étagère. Il n'est jamais grimé, sur aucune d'entre elles, et il est, sur chacune, reconnaissable au premier coup d'œil. Qui était-il ? Un ou tous à la fois ? N'y a-t-il que des visages ? Comme les cloisons mobiles des décors de théâtre, fausses perspectives dessinées sur du carton-pâte ? N'y a-t-il que des rêves promenant leur face changeante à la surface du globe ? Comme des sourires révolus ?
Oui ! il n'était jamais le même. Il n'était jamais différent, pourtant. D'une constance parfois désarmante. S'il n'aimait pas s'habituer, il avait cependant ses petites habitudes, qu'il égrainait tout au long de la journée comme des rites indéfectibles. Il n'aimait pas les départs brutaux, ni les vibrations du réveille-matin. Mais ce qu'il détestait le plus, c'était qu'on ouvre les volets alors qu'il était encore sous les couvertures. Du fond de son lit, il émergeait doucement, réveillant ses muscles un à un en s’accompagnant d’onomatopées. Ensuite, pas question de partir sans manger. Pain, saucisses, jambon, hareng parfois, fromage aussi et, les bons jours, quelques gâteries. Surtout, il ne s'aventurerait jamais dans la brume matinale sans un long détour aux toilettes, lieu sacré par excellence. Là, il passait parfois de longues heures à réfléchir, un journal à la main ou sur les genoux. Il en sortait ragaillardi, l’œil pétillant comme après un bon repas. Après un coup d'eau sur le visage, il était prêt à affronter l'extérieur, à condition toutefois de pouvoir rapidement allumer une première cigarette. Quand un de ces rites préliminaires n'était pas respecté, il grognait ou gratifiait l'entourage de regards affligés.
En tournage, il faisait partie de ceux qui réclamaient ou organisaient les pauses. Entre les prises, il aimait s’asseoir et discuter avec les personnages ou les acteurs. Il devenait rapidement leur confident. Parfois même, il en oubliait ses micros et son magnétophone et sursautait en entendant l’annonce du prochain plan. Ne lui est-il pas arrivé d’oublier où il avait rangé son matériel ? Pour autant, je crois qu’il aimait son travail, et cachait son application derrière une image de dilettante qu’il cultivait avec obstination.
Il grommelait quand on le forçait à courir pour respecter un plan de travail et ne comprenait pas pourquoi on ne prenait jamais le temps de faire les choses tranquillement. Il se plaignait des cadences imposées, de l’agitation des animateurs de télévision, de celle des journalistes, de la frénésie des équipes, de la frime, refusant de se plier aux rites de la profession.
Il résistait.
Il pouvait faire attendre une équipe entière, enrager un opérateur inquiet de l’arrivée d’un gros nuage, déclencher une crise d’hystérie chez un assistant peu maître de ses nerfs simplement parce qu’il devinait une voiture au loin ou qu’il craignait qu’un aboiement de chien ne vienne gâcher sa prise de sons.
Quand il était entre deux contrats, il passait sa matinée dans les rues de son village à s’entretenir avec les commerçants. Vers midi, il revenait chez lui, posait les provisions sur la table et jouait un air de piano avant de préparer son repas. L’après-midi, il s’occupait de son fils ou s’installait sur un cube, devant son écran, les doigts sur son clavier, réfléchissant à des nouveaux projets. Des fois, pour chercher l’inspiration, il ouvrait un jeu vidéo...
Il aimait que les jours se ressemblent, sans autre surprise que la visite impromptue d’un voisin ou les joies d’une sieste improvisée.